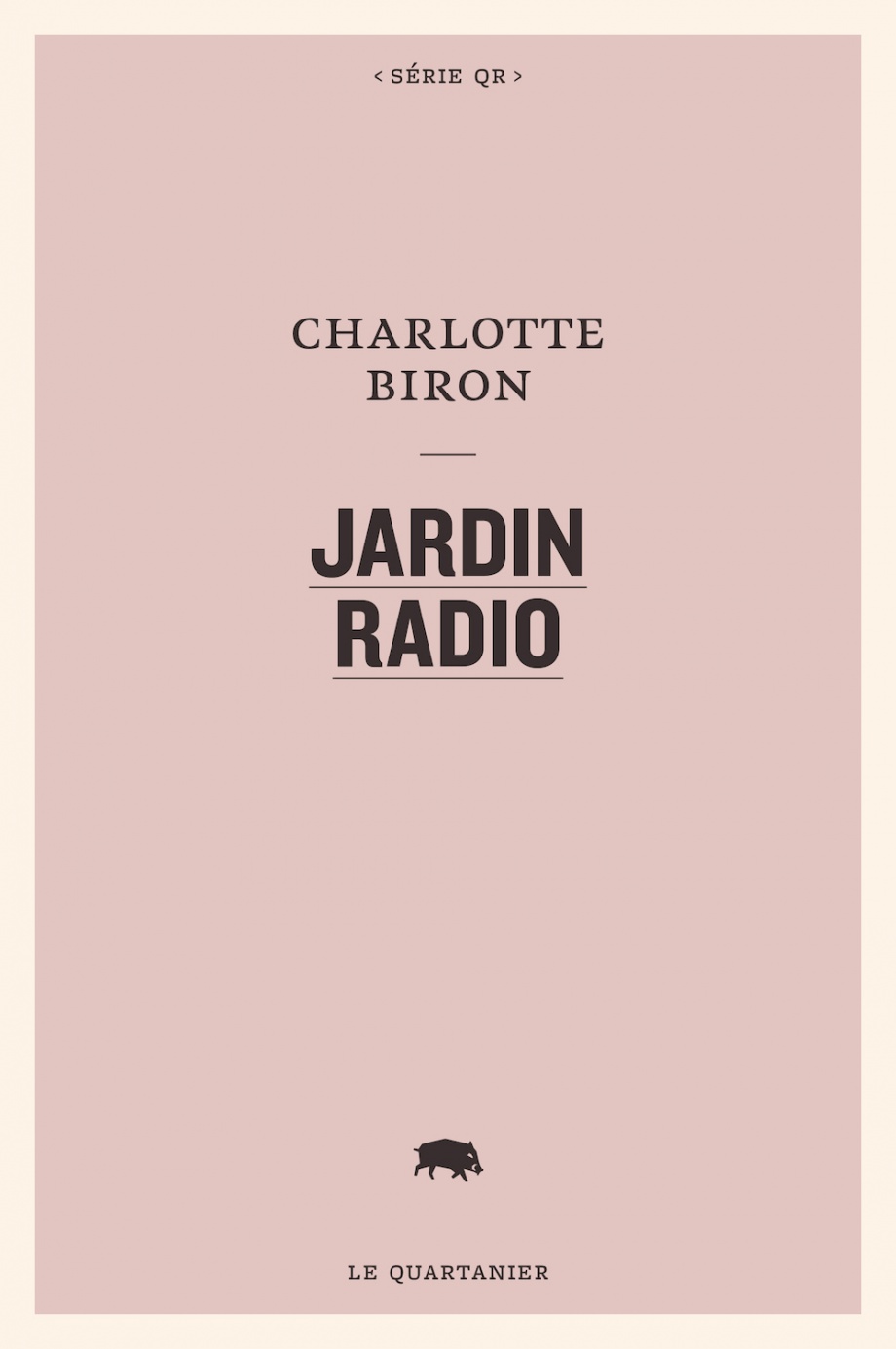Titulaire d’un doctorat sur l’histoire littéraire du reportage au Québec, Charlotte Biron est chargée de cours à l’Université Laval et chercheuse postdoctorale. En 2016, elle publie chez Codicille éditeur son mémoire de maitrise Mavis Gallant et Gabrielle Roy, journalistes, lequel lui vaut le prix de la recherche émergente du CRILCQ. Depuis une dizaine d’année, Biron s’intéresse à la matière sonore ainsi qu’à l’expérience radiophonique. En 2022, elle publie Jardin Radio aux éditions Le Quartanier, un roman autobiographique qui témoigne de la temporalité de la maladie, du diagnostic à la convalescence. En lisant Charlotte Biron, seule au bord du feu dans un chalet, j’ai suspendu ma respiration sans cligner des yeux, comme s’il fallait emprunter son souffle pour respirer avec elle. Pour parler de son écriture, j’ai eu envie de rendre compte de ce passage d’un souffle à l’autre, de ce relais qu’exige l’écoute de l’autre en soi. J’ai voulu penser cet entretien sous la forme d’une correspondance, dans un rapport d’horizontalité, car la voix, intimement liée à la présence de l’autre, exige un retour vers notre humanité commune. J’ai voulu situer le texte critique à même ce point de jonction, en cet espace où la respiration de l’une s’interrompt pour reprendre souffle en l’autre.
///
Mimi Haddam : David Le Breton, dans Éclats de voix : une anthropologie des voix, écrit : « La voix est entre les personnes qui se parlent. Elle s’adresse toujours à un autre en qui elle résonne. Elle accomplit le passage entre intériorité et extériorité, entre dedans et dehors, toujours à la fois séparation et tentative de rejoindre l’autre en colmatant l’espace par le soin et le langage ». Elle peut être comprise comme un entre-deux en lequel se rapprochent des êtres lointains. Il semble impossible de réfléchir la voix en dehors de cette interaction, de ce point de frottement entre deux forces éloignées qui deviennent alors complices d’une même lutte. Pour traverser l’épreuve de la douleur et de la solitude, tu entres dans cet espace relationnel qui, dans ton livre, prend la forme d’un jardin de matières sonores. Tu y recueilles intonations, silences, bégaiements. Alors que ta propre voix menace de disparaître, tu te rattaches aux effets que produisent les voix de femmes que tu écoutes à la radio. Parmi celles-ci, on retrouve notamment les voix de Susan Sontag, Ann Kroeber, Fanny Britt et Catherine Mavrikakis, dont les effets sonores sont toujours susceptibles de troubler la parole prononcée jusqu’à ce qu’elle déborde. Tel qu’écrit René Lapierre dans Renversement : « Si la voix écoute, il faut qu’elle y ait consenti. Non pas en faisant silence, en s’effaçant comme voix, mais en se liant à d’autres voix. En respirant et en touchant, en se mêlant avec amour de tout ce qui la regarde et de tout ce qui lui échappe ». Oscillant entre distance et proximité, l’autre s’échappe de ses propres contours alors que tu te laisses contaminée par l’émission subtile d’un langage intime qui menace sans cesse de te glisser entre les mains. Alors que d’autres femmes se greffent en toi, tu retrouves le sens de la communauté. C’est une forme d’amour : la voix permet d’être traversé·es, traversant·es. Contaminé·es, contaminant·es. Que préserves-tu des traces d’amour qui sillonnent le corps douloureux? Portes-tu encore les marques de ce « lieu où l’on se pose, ébahie »?
Charlotte Biron : Je suis contente que tu retiennes les effets sonores des voix et que tu parles des intonations, des silences et des bégaiements qui sont dans le livre. En fait, cet intérêt ne concerne pas seulement les artistes que j’admire. Je remarque les particularités des voix de tout le monde. Les tics de langage du père de mon ex. Les raclements de gorge de mon voisin. Les mots préférés d’Yves qui fait la circulation tous les matins. Ça allait bien, jusqu’à il y a quelques minutes, Patrick, là, ça s’est gâché.
Prendre la parole, c’est une chose que je ne fais jamais sans la présence des autres, que cette présence soit réelle ou imaginée. Je suis toujours étonnée d’entendre des gens prendre la parole longtemps sans s’inquiéter d’ennuyer le monde ou sans demander une réponse. Je ne suis pas comme ça. J’ai besoin d’un retour et j’ai peur des discours qui effacent ceux des autres. Je ne veux pas parler toute seule. C’est vrai même quand j’enseigne. J’ai besoin d’entendre les étudiant·e·s. Je ne peux pas m’adresser au vide pendant des heures. Parler est une chorégraphie.
Tu écris que c’est une forme d’amour que de porter une attention aussi précise aux voix des autres au point de les laisser entrer en soi complètement. C’est très beau ta formulation, mais dans la vie, la plupart du temps, je suis comme tout le monde. Mes journées vont vite et je n’ai pas le temps de noter ce que je remarque, de m’arrêter aux paroles pour les enregistrer, de réfléchir à ce qu’elles produisent. Il faut être freinée, être à l’arrêt, il faut être sur pause. Je voudrais avoir plus de temps pour écouter.
Je m’éloigne du sujet. Pour répondre à ta question, je dirais : oui, oui, je garde en moi les traces de la voix des autres et c’est rassurant.
MH : Dans ton livre, c’est la voix qui instaure le sujet. À l’écoute des inflexions de la matière sonore, à côté du monde et solitaire, tu es appelée par « une femme nombreuse, pourrait-on dire, une femme plurielle, une femme qui alterne avec elle-même, une femme qui se démultiplie ». Cette femme nombreuse n’existe-t-elle qu’à travers l’expérience de la douleur? Devient-on multiple parce que le corps nous déserte?
CB : C’est un passage où je parle des secrétaires médicales (envers qui j’ai beaucoup de respect). J’essaie de raconter qu’elles agissent dans un système qui est d’une très grande violence pour elles et pour les malades. Quand la secrétaire médicale appelle, c’est n’importe qui. Elles changent constamment, on n’apprend pas leur nom, on ne les reverra pas et si on les revoit, rien ne nous autorise à créer un lien. Si on le fait, c’est en dépassant les lignes. Le système de santé est segmenté pour que personne ne soit véritablement responsable de personne. Autrement dit, ni les secrétaires médicales, ni les médecins, ni les technicien·nes n’ont véritablement de compte à rendre aux patient·e·s. C’est à la personne malade de gérer son problème et de faire un suivi auprès de chaque intervenant·e. Les gens qui travaillent dans le système de santé complètent leur tâche, leur part dans le parcours du malade. Si chacun de ses individus suit la procédure à la lettre, le résultat est absolument horrible. Il faut que l’une de ces personnes décide par elle-même de faire un peu plus, de dépasser son mandat. Je ne dis pas que c’est la faute des secrétaires ou des médecins, mais bien du système.
Ce système, qui prive les malades de relations avec les gens du milieu de la santé, produit une banalisation presque insoutenable de la vie des patient·e·s. Une fois malades, on devient tou·te·s pareil·le·s. On devient anonymes. On se multiple. Et cette banalisation de l’expérience des gens est encore plus vraie pour toutes les personnes dont les voix portent moins loin dans l’espace public : les femmes, les personnes de groupes minorisés, les personnes qui proviennent de milieux défavorisés.
MH : Dans l’essai Zizanie de Clara Schulmann, l’autrice dépeint le pouvoir de reconfiguration identitaire de la voix. Elle écrit : « Nos identités ne cessent de se reconfigurer, et, d’une certaine manière, elles n’attendent que ça. La voix, la nôtre, telle qu’elle se transforme, s’adapte, se crispe, nous échappe, nous signale l’amplitude de ces reconfigurations, de ces potentialités ». Chacun·e possède de multiples voix, à l’intérieur de son propre spectre vocal. Elles se métamorphosent, provisoires, sans cesse rejouées, polyphoniques. Et pourtant, bien qu’elles soient intimement liées à notre identité, on ne sait pas d’où elles parlent. Lorsque tu écris : « À peine l’identité affleure-t-elle qu’en son timbre déjà le silence revient et replonge l’espace dans un noir tranquille », l’association des mots « noir » et « tranquille » m’intrigue. Cela me fait penser à un passage dans La voix, entre l’audible et le visible de Guylaine Chevarie-Lessard : « La voix c’est ce qui ne peux pas s’exposer, c’est ce qui ne peut se penser qu’à travers ce qu’elle n’est pas ». Comment décrire cet espace?
CB : Quand j’ai écrit la phrase que tu cites, je pensais à ce pouvoir qu’a la voix de nous faire apparaître sans être vu. Le corps n’a pas besoin d’être observable pour que la voix nous fasse exister. On existe entièrement avec notre voix. Entendre une voix, ce n’est pas seulement du bruit, c’est entendre quelqu’un. On perçoit une identité, on reconnaît dans la voix l’existence pleine, complète, entière d’une autre personne, qu’on est activement en train de construire. Les gens disent souvent que la voix marque la présence du corps en creux. Bien sûr, c’est vrai, on imagine un corps, mais on imagine aussi un âge, une condition de vie, un contexte, des rêves, des blessures, une émotion. Entendre une voix nous fait imaginer une personne entière. Et le noir tranquille, c’est l’espace où rien n’a besoin d’être vu ou touché, ce lieu où l’on crée une personne simplement en ayant eu accès à sa voix.
MH : Bien qu’elle excède les ressources de la figuration, la matière sonore est traversée par des forces vitales et affectives qui font appel à une forme d’intelligence empathique. Tu fais l’expérience de cet « endroit à part entière » qui t’accompagne dans la convalescence. L’espace de la voix devient « un refuge ou viennent s’éroder les angles acérés du chagrin », tel que l’écrit David le Breton. Bien qu’elle permette une rencontre consolatrice avec l’autre, la voix se retire, s’échappe. On entre dans une temporalité désordonnée, une sorte de corporalité immaîtrisable, non localisable, et pourtant, immédiatement présente, ancrée au plus près du corps. La voix enregistrée « contient chaque minute. Elle ne concède ni ne condense rien. Sa précision défie la mémoire. En même temps, elle ne respecte pas de chronologie. Elle n’ordonne pas le passé, ne restitue pas le déroulement des faits ». Ici, il s’agit plutôt de s’abandonner au libre cours d’un espace qui nous kidnappe en même temps qu’il nous étreint. Faut-il consentir à cette dépossession de soi qui relève à la fois d’un crime et de l’amour? L’écriture de la douleur est-elle un enlèvement qui exige de revenir à soi avec douceur?
CB : L’écriture de la douleur ne m’intéressait pas au début du projet, parce que je ne voyais pas l’intérêt de faire lire un journal de mes souffrances aux autres, en sachant très bien que moi, personnellement, je n’aurais jamais envie de lire une telle chose. Ce qui m’interpelait au départ, comme tu le soulignes si bien, c’est l’espace-temps étrange où l’on se trouve au moment où l’on éprouve cette douleur.
Je n’aime pas le mot dépossession dans le cas de la maladie, parce que ça sous-entend qu’on est un peu moins nous-mêmes lorsqu’on souffre, lorsqu’on perd un morceau de nous, lorsqu’on est alité·e·s ou épuisé·e·s. C’est une question récurrente dans les textes sur la maladie : suis-je encore moi à travers l’épreuve de la maladie? Suis-je encore la même personne si je ne parviens plus à faire tout ce que je faisais auparavant et qui me définissait? Or, cette façon qu’on a de se définir à travers ce que l’on fait et surtout ce que l’on réussit à faire m’énerve. C’est la cause d’une détresse profonde pour les gens qui se sentent incapables de travailler et de fonctionner normalement. Mais tu as raison, la douleur nous force à réévaluer toutes ces croyances qui nous pourrissent de l’intérieur. La souffrance nous oblige à exercer une douceur nouvelle envers nous-mêmes.
MH : En portant une attention particulière aux affects qui traversent les voix que tu écoutes, tu participes à une « forme de communication radicale et inédite ». De l’ordre de la réceptivité sensible, ton écriture prend acte, non pas à travers une pensée conceptuelle, mais au cœur même des sensations les plus latentes. En plaçant à l’avant-plan cette dimension sensible, tu participes à une déconstruction du savoir, et ton œuvre témoigne d’un désir de dé-académiser la littérature. Plus largement, elle remanie les structures de pouvoir en revendiquant la nécessité d’une qualité d’écoute, d’une réparation. Et pourtant, tu écris : « j’enlève les accents de pathos et de tristesse. Je dépose sur le trottoir des phrases calmes, étrangères aux pulsations dans mon cou. La syntaxe et les mots ne doivent ni hurler ni geindre. J’essaie de me rapprocher des faits, d’effacer les émotions, de ne pas bégayer en parlant de douleur ». Que dénonce cette distance émotive? Participe-t-elle d’une forme de communication radiale?
CB : De ne pas pleurer et de ne pas geindre, ce sont des impératifs qui proviennent de l’extérieur, des milieux où la narratrice circule dans le livre : l’université et l’hôpital. Ce n’est pas une exigence que la narratrice entretient elle-même. Même la littérature n’aime pas particulièrement les gens qui geignent, mais la littérature est aussi un espace d’invention. Je voulais créer un livre où on entendrait des gens se plaindre et s’apitoyer sur la peine qu’elles et ils ressentent. C’est ce qu’on entend dans les guitares de Martín Rodríguez et dans la voix de Cat Power. Mais je voulais que ce livre inclue aussi d’emblée des peines qui ne sont pas les miennes et dont on ne connait pas l’existence, ta peine à toi ou celles d’autres lecteur·ice·s. La distance émotionnelle, elle m’a été utile pour parvenir à entrer dans le détail de ce que l’on peut tous·tes vivre durant ces moments et qu’on a souvent du mal à nommer.
J’aime aussi ce que tu dis sur le fait de sortir le texte de l’académie, parce que je ne voulais pas m’adresser à la communauté universitaire. Le texte, je l’ai écrit à l’abri de l’université. Je n’essaie pas de déconstruire ou de rendre accessible des savoirs ou des textes : je cite des gens par nécessité, par besoin réel d’être en relation avec ces voix. Bien sûr, ça fait dix ans que je grenouille dans le milieu universitaire et il y a plein de gens que j’aime qui lisent le livre dans ce milieu, mais il n’y a aucun désir d’obtenir l’aval du monde académique dans le livre. Ce n’est simplement pas mon but. Je veux que tout le monde puisse l’ouvrir et que tout le monde comprenne exactement ce que je veux dire sur Sontag sans avoir besoin de suivre de cours préalables ou de connaître des notions théoriques.
MH : Tu rends visible une réalité marquée par la marginalisation et l’isolement qui, dans ton roman, se manifeste par la singularité d’une écriture brute et précise, refusant l’académie et allant directement au cœur de l’expérience de la marginalité. Comme tu l’écris : « Je voudrais un texte qui ne dise rien d’intelligent, qui témoigne d’une expérience à côté du monde, violente, ennuyante, invisible ». Nous devons tendre l’oreille à ces voix invisibilisées, affiner notre sens de l’écoute envers ces paroles trop longtemps réprimées afin de lutter contre les forces homogénéisantes qui cloisonnent le monde actuel. En témoignant de l’expérience de la maladie tant individuelle qu’universelle, ton œuvre agit comme un outil de contestation sociale et politique qui fait appel au devenir, aux multiplicités qui nous habitent et à ce que peuvent les corps disloqués, désertés, greffés.