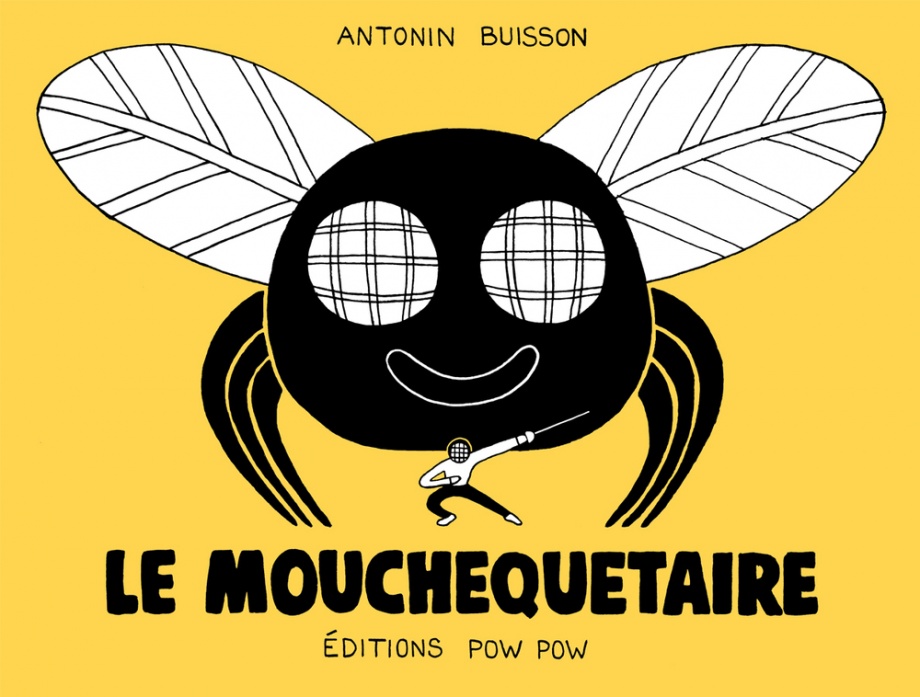Sang. Texte : Lars Norén ; traduction : René Zahnd; mise en scène : Brigitte Haentjens ; avec Christine Beaulieu, Alice Pascual, Sébastien Ricard, Émile Schneider ; une création de Sibyllines en coproduction avec le Théâtre français du CNA. Présenté à l’Usine C du 28 janvier au 15 février 2020.
///
Suite au coup d’État du 11 septembre 1973, Éric et Rosa ont dû fuir leur Chili natal en y abandonnant leur fils Luca, alors âgé de sept ans. On les retrouve vingt ans plus tard, en France : elle est devenue une journaliste militante de premier plan, et lui, un psychanalyste reconnu. Bien qu’ils ne l’admettent qu’à demi-mot, on comprend vite que cette séparation n’a cessé de les hanter, au point de mettre leur couple en péril. Éric ne la désire plus et entretient même une relation adultère avec un jeune homme, dont on devine aussitôt qu’il est le fils disparu. C’est ainsi que Lars Norén nous offre une énième réécriture du mythe d’Œdipe avec sa pièce Sang, une proposition convenue dont on pourrait certes questionner la pertinence. Cela dit, ce texte n’a heureusement pas la prétention d’entretenir un suspense chez les spectateur·trices : à plusieurs occurrences, les personnages vont jusqu’à référer explicitement au mythe, ce qui ouvre finalement un espace de réflexion salvateur.

Le confort des dispositifs sociaux
La scénographie de Sang est assurément fascinante; on sent qu’elle a été finement réfléchie. Les spectateur·trices se rendent à la salle comme dans un labyrinthe à travers les coulisses de l’Usine C. Une fois sur place, la scène – à mi-chemin entre l’arène de combat et le plateau de télévision, avec son public réparti sur ses quatre faces – est intrigante de possibilités. Sur les écrans disposés à chaque coin du « studio », on aperçoit ensuite les comédien·nes emprunter le même chemin, alors qu’un régisseur dispose les accessoires nécessaires à la représentation sur le plateau. Puis, au signal, tout démarre, comme si on assistait à un enregistrement télévisuel. Cette habile touche de mise en scène annonce d’emblée le discours sur la surmédiatisation et le formatage de nos rapports humains qui traversera toute la pièce.
Si le texte de Sang comporte des perles de rhétoriques, il est aussi par moment verbeux, particulièrement dans les scènes d’entrevues – ce qui n’empêche pas Alice Pascual d’y être d’une irréprochable efficacité. En fait, cela permet de souligner le caractère construit de ce genre de dispositif. Rosa le mentionne : sous l’œil des caméras, elle avait l’impression de ne plus être elle-même, de ne plus savoir ce qu’elle disait, voire de s’exprimer d’une façon qui n’était pas la sienne. Comme si elle répondait inconsciemment à des codes qui la dépassent de façon à respecter le contrat social, lequel n’est qu’accentué par la spectacularisation du monde qu’encouragent les médias, où on a l’impression de constamment devoir répondre aux attentes d’un public réel ou fantasmé.

On pourrait dire la même chose du ton catastrophé qui entoure le sida ou les rencontres sexuelles multiples du fils dans l’espace de la pièce. Dans les deux cas, ces informations sont mal reçues par Éric, qui incarne le discours psychanalytique. Il tente de raisonner son jeune amant, d’interpréter ses agissements, de le ramener à l’ordre, alors que c’est peut-être justement dans ces moments de purs désirs que Luca se sent le plus vivant. On se demande alors : pourquoi avons-nous si peur de l’inconnu, de ce qui est désorganisé, de ce qui échappe à la mise en récit ?
La salutaire sortie du mythe
On nous amène ainsi à réfléchir à notre propension à nous mettre constamment en scène dans nos interactions (c’est d’ailleurs l’idée au cœur des travaux du sociologue Erving Goffman), à notre besoin inconscient de toujours associer le vécu à des scripts, comme le fait ironiquement – suppose‑t‑on – Lars Norén en réactualisant le mythe d’Œdipe.
À ce titre, on peut dire que l’intérêt de ce spectacle réside avant tout dans cet écart entre le rôle social qui est performé par les personnages et ce qui est perçu de leurs désirs par les spectateur·trices, un décalage qui ne fait qu’en accentuer l’aspect représentationnel. En effet, les plus beaux moments de Sang, les plus vrais, sont ceux où les personnages agissent impulsivement, moments insaisissables où leurs désirs leur font perdre le contrôle. Les comédien·nes le rendent parfaitement : on touche, dans les scènes entre le père (Sébastien Ricard) et le fils (Émile Schneider), à une fébrilité et à une fougue des plus touchantes. Et on ne se contenterait au final que de cela, hors de toute raison, de tout récit tragique culpabilisant qui ne fait que désamorcer la charge primitive de tels moments. Comme l’appuie d’ailleurs la mise en scène de Brigitte Haentjens, l’échec advient précisément dès qu’on essaie d’organiser, ou encore de simplifier les pulsions. Ainsi, la scène de la révélation de l’inceste, à la fin, n’a volontairement rien de bouleversant – elle va de soi à un point tel qu’elle en est agaçante –, et l’absurdité de la chose n’est qu’accentuée par une chorégraphie tragique qui évacue toute authenticité.

En un sens, c’est tout ce discours critique qu’incarne aussi le fils dans les derniers instants de la pièce, alors qu’on revient au format de l’entrevue télévisée. L’animatrice tente de lui soutirer des informations à propos du meurtre de ses parents, en en soulignant bien sûr le caractère œdipien. Mais comme le spécifie Luca, bien que son histoire soit effectivement similaire à celle d’Œdipe sur certains points, elle s’en distingue sur d’autres, notamment par le fait que lui n’est pas, contrairement au héros grec, devenu aveugle. Au contraire, c’est peut-être justement la fin (et donc la sortie) du mythe qui lui a enfin permis de mieux voir, d’échapper à son destin, et de vivre librement. C’est pourquoi il souhaite que tout soit dit : pour toucher à la vérité, pour qu’on ne tente pas de réduire la passion qu’il a vécu avec Éric et Rosa (qui étaient accessoirement ses parents) à un mythe tragique ancien, ce qu’elle n’était pas fondamentalement, c’est-à-dire avant que le discours social s’en mêle et la condamne.
Ce que pointe ce spectacle, c’est donc peut-être surtout notre peur de la sauvagerie, que nous raisonnons sans cesse par des mises en récit manichéennes : ainsi les impulsions, belles et vraies des personnages, sont toujours avortées (les scènes de sexualité et de violence, notamment) ou encadrées par une spectacularisation rassurante. On pourrait certes déplorer cet aspect du texte de Lars Norén si on l’abordait superficiellement, mais il faut justement dépasser ce premier niveau de compréhension pour en apprécier la facture critique, car elle est assurément l’élément le plus louable de cette réécriture lucide. Cette dernière permet, au final, d’amener la réflexion ailleurs en critiquant plutôt notre constant besoin de tout organiser en adhérant aux schémas narratifs qui nous précèdent.
crédits photos : Jean-François Hétu