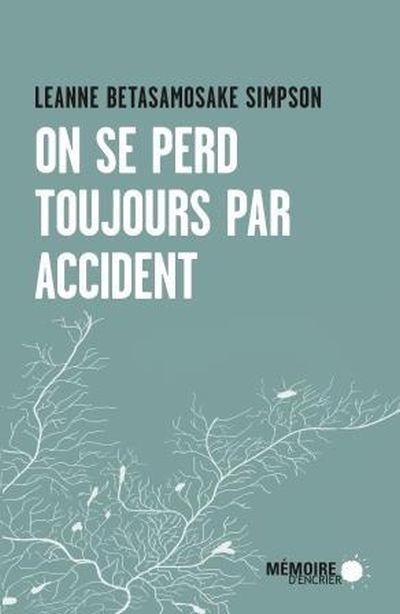Daddy, Antoine Charbonneau-Demers, Montréal, autopublication sur gumroad.com, 2020.
///
Alors que nous expérimentons présentement de nouveaux types d’isolement et de solitude, un nouveau rapport au temps et à l’espace s’impose à nous. Plusieurs ont perdu leur emploi, d’autres font du télétravail. Sur les réseaux sociaux, on constate que beaucoup de gens, prisonniers de leur chez-soi, ont tellement de temps devant eux qu’ils font des pieds et des mains afin de trouver des manières originales de se changer les idées et de remplir leur quotidien. Même au cœur de la crise, on a l’impression de ne jamais être assez productifs, accentuant notre anxiété de performance habituelle, notre sentiment d’échec, notre épuisement, voire notre impression de perte de contrôle alors que quelque chose d’insaisissable fait rage à l’extérieur. Puis on se surprend, comme le narrateur du nouveau roman d’Antoine Charbonneau-Demers, à fantasmer pour chasser l’ennui et la crise existentielle qui nous guette : « Imaginez tout ce que vous voulez accomplir, […] imaginez le nombre d’abonnés Instagram que vous pourriez avoir, l’argent dans votre compte en banque, vos lèvres gonflées, vos dents refaites, imaginez le nombre d’hommes qui viendraient vous fourrer, tout le succès que vous pourriez avoir en France, votre future carrière d’acteur porno, votre santé sexuelle parfaite et votre parfaite indépendance. Imaginez votre rêve. »
Troisième roman de l’écrivain rouynorandien, Daddy est une plaquette de 90 pages écrite et autopubliée dans l’urgence de la crise : « Maintenant que nous sommes en quarantaine, je me suis dit : bon, ça y est, les écrivains vont se mettre à écrire. Leurs livres sortiront bientôt et ça va être du génie. C’est dans l’esprit de compétition que je me dépêche à écrire ce livre. Je veux tirer mon épingle du jeu. Je suis jaloux du succès de mes pairs et je ne suis jamais content pour eux. […] Mon livre, je ne veux pas qu’il soit bon, je veux juste qu’il sorte. […] Je veux que le monde entier sente qu’il m’imite. » En fait, on constate que ces événements confrontent surtout l’auteur à sa solitude, ses échecs et sa non-productivité, lui qui dit « ne rien faire d’autre » comme s’il statuait n’en faire pas assez. : « Je suis écrivain et je ne fais rien d’autre, c’est à n’y rien comprendre, où est-ce que tu prends ton argent. Je ne fais pas que ça. Je me fais baiser et je prends des photos de moi dans mon appartement. J’écris plein de livres, mais je ne les finis pas. » On sent sa honte et l’emprise qu’a le regard d’autrui (suggéré ici par l’adresse au « tu ») réel ou fantasmé sur son existence constituée de projets avortés et de mises en scène de soi superficielles.
S’« il est prévu que ce roman raconte [s]a passion pour Daddy », son amant, ce qui en fait la force, c’est surtout les parallèles entre la « grande » et la « petite » histoire d’emmurement, c’est-à-dire entre l’isolement exceptionnel imposé par la pandémie, et la façon dont le narrateur, cette « personne manquée », s’isole quotidiennement dans son corps et dans sa honte, comme « on mure les sluts dans leur solitude » : « Si j’étais libre de sortir, je me sentirais libre, mais peut-on se sentir libre, confiné dans son appartement, quand un virus mortel se propage à l’extérieur? » La ligne s’estompe entre le confinement à l’appartement et le confinement à un corps désirant ou à une identité. En cela, Daddy est assurément le plus maîtrisé et le plus abouti des romans écrits par Charbonneau-Demers : chaque fragment s’y imbrique aux autres avec une cohérence qui est des plus réjouissantes.
La peur de l’échec, l’anxiété de performance et la crainte de perdre le contrôle par rapport à l’impression qu’il produit sur autrui emprisonnent Charbonneau-Demers dans un carcan qu’il ne peut fragiliser qu’en se soumettant aux interdits. La façon qu’il a de mélanger tendresse et violence au cœur de son écriture, qu’on sentait déjà poindre dans ses précédents romans, produit alors une beauté abjecte qui est aussi déchirante qu’émouvante : « Il m’a baisé et c’était une heureuse révélation, cette violence. » ; « J’avais le visage plein de larmes quand il m’enfonçait sa grosse queue dans la bouche parce que c’était trop gros. Il les essuyait avec un sourire. Nous nous étions trouvés. » ; « Enfant, j’étais Lolita qui attendait qu’on abuse de moi. Les tout premiers mots que j’ai écrits sérieusement, dans l’idée d’un projet littéraire, […] c’étaient ceux-là : “Je veux qu’on me viole.” […] Ça racontait que tous les hommes d’un village m’étaient passés dessus et que j’étais enfin soulagé. » Cette esthétisation de la violence est aussi en partie liée aux sentiments de culpabilité et de jalousie qui ponctuent tout le roman. Il envie les universitaires – « Je les dédaigne parce que je les jalouse, […] encore à me plaindre de na pas être un intellectuel comme eux. » – et ses amis gays – « J’aimerais être comme eux. » Il se sent coupable du décès de sa mère, morte d’un cancer, de celui de son grand-père, mort du coronavirus, se sent honteux de ne pas arriver à se confier à ses amies. En fait, il s’inquiète de « tout ce qu[’il] n’[a] pas », parce que derrière une façade finement érigée, il a surtout un grand besoin de vivre et de plaire, d’être désiré, voire aimé en unissant sa solitude à celle des autres. Pour ce faire, il goûte égoïstement à tout ce que la vie lui offre, avec ce que cela comporte de risques.
« Après trois années de Conservatoire à forcer comme un malade pour faire sortir des larmes qui ne sortaient pas, une voix qui ne sortait pas, une virilité qui ne sortait pas, une passion qui ne s’inventait pas », au moment où il est « écœuré du métier d’acteur à jamais », Charbonneau-Demers décide, avec ce roman, « de ne plus écrire de fiction » ; la scène où il fantasme qu’il urine sur son masque du Conservatoire est d’ailleurs assez évocatrice. Mais aussitôt, sa hantise de l’échec refait surface : « Mais j’ai peur que, sans fiction, mes livres soient sans intérêt, alors je ne les finis pas. » Ce contre quoi il lutte, c’est d’abord cette peur de la vérité qu’incarnent parfaitement ses amitiés, ce dont il est d’ailleurs question à plusieurs occurrences. En cela, le contexte dans lequel s’inscrit le roman n’est pas anodin : l’urgence qui en a motivé l’écriture ne laisse de place ni à l’autocensure ni à l’érection des barrières protectrices qu’il évoque, et une grande authenticité peut alors émerger.
Charbonneau-Demers touche dans ce texte à une sensibilité et à une vérité qu’on ne trouvait pas aussi uniformément dans ses œuvres précédentes. Comme le lui confie un ami dans l’une des scènes du roman, « ça se voyait […] quand c’était vrai, et quand c’était de l’invention ». Non pas que la vérité autofictive importe, elle est même de peu d’importance, mais cette sorte de sincérité du sentiment (présente jusque dans les reproductions d’échanges de textos, troublants de réalisme) apporte un nouveau souffle à son écriture, en produisant une forme de laisser-aller. En fait, tout le roman évoque, jusque dans ses épisodes les plus crus, cette libération qui fait mal autant qu’elle fait du bien : « Il est venu me baiser et c’était le plus beau jour de ma vie. Les masques étaient tombés. On ne jouait plus. C’était de la folie, de l’euphorie. » Et si, reprenant les propos de Christine Angot, le narrateur songe à un moment au fait que la littérature se cache souvent là où il n’y en a pas, on peut au moins affirmer sans se tromper que la vérité de cette tension à laquelle touche Antoine Charbonneau-Demers dans Daddy donne lieu à de la grande littérature.